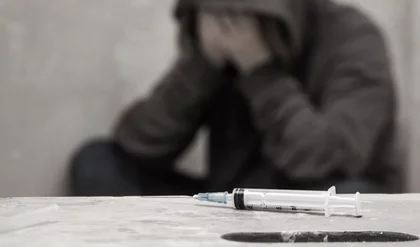Donner une « photo à l’instant T » et fournir des clés pour cheminer vers une association plus inclusive. C’est ce que propose l’« Inclusiscore », un outil d’évaluation lancé la semaine dernière par le Mouvement associatif après 18 mois de travail. A l’origine de cette initiative : l’envie de lutter contre toutes les formes de discrimination. « Nous avons été touchés par le fait qu’on aborde souvent la question de l’inclusion d’une manière un peu restrictive, principalement à travers le rapport au handicap, représenté par cette petite icône d’une personne en fauteuil roulant qu’on affiche sur la devanture de certains établissements, rapporte Anne-Claire Devoge directrice générale adjoi
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?