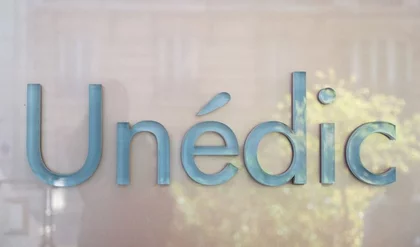Actualités sociales hebdomadaires - La pauvreté des élèves est rarement évoquée dans les débats sur l’école. Pourquoi ?
Choukri Ben Ayed : Le sujet a déjà été abordé par les rapports « Joutard » en 1992 et « Delahaye » en 2015, qui ont marqué une prise de conscience. Mais, depuis, cette problématique est passée entre les mailles du filet. Or les données statistiques internationales montrent que le système scolaire français est devenu l’un des plus inégalitaires parmi les pays développés, particulièrement en Europe. Les données produites s’appuient sur des variables assez générales – élèves « favorisés », « défavorisés » – qui renseignent peu sur leurs conditions de vie réelles. Les espaces locaux où se concentre la grande p
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?