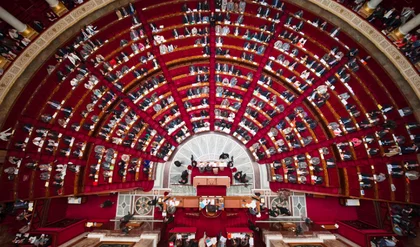Juge aux affaires familiales, juge des enfants : qui fait quoi ou, dans un langage plus orthodoxe, quelles sont leurs compétences respectives ? La réponse parait simple. En théorie, du moins...
Les compétences du juge aux affaires familiales (JAF) sont déterminées aux articles L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire et 373-2-6 du code civil. Le JAF statue notamment sur le divorce et l’autorité parentale. Les compétences du juge des enfants (JE) sont indiquées aux articles L. 252-2 du code de l’organisation judiciaire et 375 du code civil. Il a en charge la protection de l’enfance et la petite délinquance juvénile.
Examinons quelques-unes de leurs compétences respectives. Non sans préciser au préalable qu’en pratique, il en résulte parfois des décisions factuellement contradictoires, même si leurs fondements juridiques sont différents .
>>> Sur le même sujet : Abus de faiblesse : méthodologie au service des travailleurs sociaux
Concernant le juge aux affaires familiales, l’article 373-3 du code civil dispose qu’il peut, « à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsqu’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale, décider de confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté ». Certes, « confier » (JAF) n’est pas « placer » (JE), mais pour le justiciable la différence n’est pas flagrante.
Logique de protection
Le juge des enfants peut donc « placer » l’enfant, éventuellement chez un parent, alors même que l’autre parent se l’était vu confier par le juge aux affaires familiales, par exemple dans le cadre d’un divorce. Ce placement est par définition temporaire, mais il est souvent reconduit jusqu’à la majorité de l’enfant, voire jusqu’à ses 21 ans. Il est théoriquement sans effet sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sur laquelle ne peut intervenir que le juge aux affaires familiales. Mais pas tout à fait, en réalité, car l’article 375-7 du code civil permet au juge des enfants, certes exceptionnellement, d’autoriser la personne, la famille ou le service d’accueil, à prendre, en lieu et place des parents, une décision relevant normalement de l’exercice de l’autorité parentale, comme autoriser l’enfant à partir en colonie de vacances ou à subir une intervention chirurgicale.
Le placement obéit à une logique de protection, qui permet en quelque sorte au juge des enfants de mettre entre parenthèses une mesure ordonnée par son homologue aux affaires familiales. Lorsque la protection n’est plus requise, la décision initiale du JAF se « réactive ». Le cas échéant, par exemple si les parents se séparent pendant une période de placement, l’un d’eux ou le procureur de la République peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il statue sur l’autorité parentale (code civil, art. 373-2-8).
Un juge unique de la famille ?
Lorsque j’anime des formations pour des travailleurs sociaux, en leur exposant les compétences respectives de ces magistrats, j’entends régulièrement formuler la suggestion suivante : mais pourquoi ne pas les fusionner en un juge unique de la famille ? Question pertinente que j’avais soumise à un juge des enfants. Il m’avait rétorqué qu’il valait mieux conserver un « double regard » sur certaines situations. Pourtant, en 2009, les pouvoirs publics avaient timidement pris acte de cette dichotomie : les articles 1072-1 et 1072-2 du code de procédure civile obligent chacun de ces magistrats à vérifier si l’autre n’a pas déjà été saisi par les mêmes parties.
>>> A lire aussi : L’assistante sociale du travail face aux risques psychosociaux
Sage précaution quand on sait qu’un bon tiers des saisines du juge des enfants serait le fait d’un des parents, sans passer par le dispositif des informations préoccupantes et signalements, donc sans filtre. Le but de la démarche est notamment d’obtenir du juge des enfants ce que le JAF leur a refusé, en invoquant nécessairement un danger pour l’enfant, résultant souvent d’une maltraitance. De telles accusations sont évidemment graves si elles sont fondées, mais elles sont également dévastatrices si elles sont mensongères.
Un autre argument qui m’avait été avancé par un magistrat hostile à la fusion est la compétence pénale du seul juge des enfants. Mais il est permis de discuter de sa pertinence. Voici pourquoi.
Agir en amont
Le volet pénal, dans le cadre du traitement de la délinquance juvénile, est une compétence que le juge des enfants ne partage pas avec son collègue des affaires familiales, même si celui-ci peut condamner un parent à une amende civile si ses décisions ne sont pas respectées. On relèvera que de nombreux jeunes présentés au juge des enfants dans le cadre de la délinquance sont déjà connus de lui au titre de la protection. Or l’efficacité en matière de protection de l’enfance commande d’agir en amont, dès le déchirement des liens familiaux. La défaillance parentale est en effet souvent la première cause du dérapage des adolescents, tout particulièrement à la suite d’un divorce ou d’une séparation des parents.
Lorsque le père est absent, il est extrêmement difficile pour la mère, notamment dans un contexte socio-économique défavorable, d’exercer son autorité parentale. Livrés à eux-mêmes, certains mineurs sont happés par un environnement parfois propice à les entraîner vers la délinquance. Il serait par conséquent opportun que des mesures de protection, qu’elles relèvent ou non de l’assistance éducative, puissent être prises le plus tôt possible, dès que le juge du divorce, ou celui saisi par un parent à la suite d’une rupture d’un couple non marié, constate leur nécessité, généralement en s’appuyant sur une enquête sociale, une expertise médico-psychologique, ou une audition des enfants.
>>> A lire également : Mandataires judiciaires : quelles pièces fournir pour une demande d’agrément ?
En 2016, la fonction de juge des tutelles des mineurs fut retirée au tribunal d’instance pour être confiée au juge aux affaires familiales. Nous n’avons donc plus que deux magistrats au lieu de trois, chargés du « sort » des enfants. Pourquoi pas un seul ? Invoquer la nécessité d’un double regard ne revient-il pas à marquer une sorte défiance à l’endroit de l’institution judiciaire, un paradoxe, lorsqu’elle émane de magistrats, d’autant plus qu’il existe des voies de recours et qu’ils peuvent s’appuyer sur des experts ? Au contraire, la fusion des JAF et des juges des enfants ne contribuerait-elle pas à une organisation judiciaire plus rationnelle, efficace, rapide sans être expéditive, au bénéfice du justiciable, en particulier l’enfant, et peut-être des finances publiques ? La protection de l’enfance est régulièrement sur la sellette, malgré la profusion de lois. Manque de moyens ? Enjeux budgétaires entre l’Etat et les collectivités ? A suivre, donc !
>>> Institut de droit pratique : www.idp-formation.com