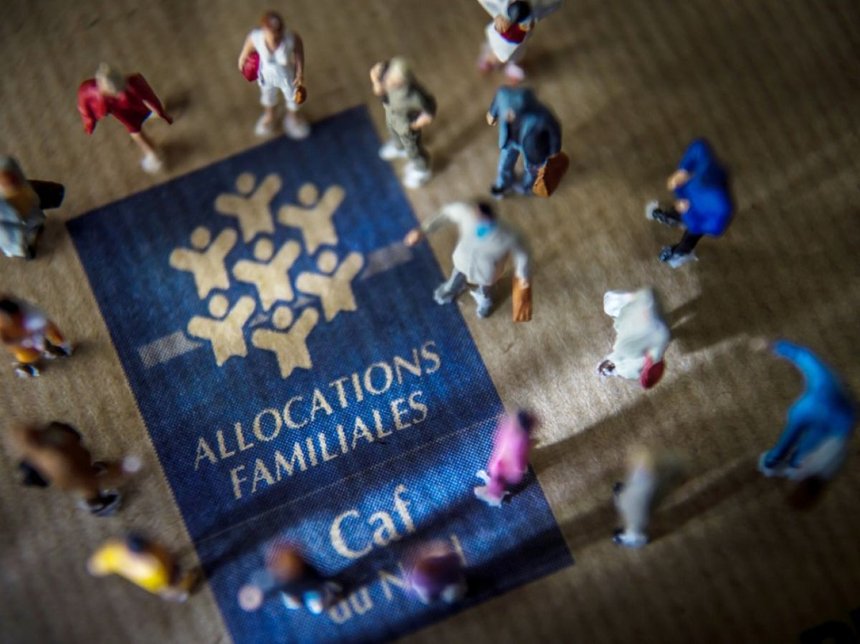La Drees (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) vient de publier l’édition 2022 de son ouvrage « Minima sociaux et prestations sociales » qui permet de faire le point sur les différents dispositifs assurant la redistribution en faveur des plus modestes et sur leurs conditions de vie.
L’un des enseignements de cette étude, fondée sur les chiffres de 2019, est l’impact des prestations sociales sur la diminution du taux de pauvreté monétaire. Ce dernier a globalement reculé de 7,6 points grâce à la redistribution des multiples prestations – allocations, aides au logement, chèque énergie et autre prime d’activité – jointe à
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?