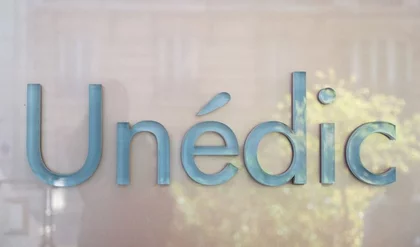Depuis 2015, l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) tente de « dresser un panorama global » de la situation dans les quartiers prioritaires. Sa dernière édition, consacrée au « bien-vivre » des habitants, met en lumière un cadre de vie « dégradé ».
Ainsi, 36 % des résidents rapportent que les parties communes ou les équipements à l’intérieur de leur immeuble sont en mauvais état (1) (ascenseurs mal entretenus, boîtes aux lettres endommagées, tags…). Ce chiffre descend à 16 % lorsqu’on interroge les habitants des quartiers environnants.
Un sentiment d'insécurité
Préoccupés par le bruit, la délinquance, l’environnement sale ou mal e
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?