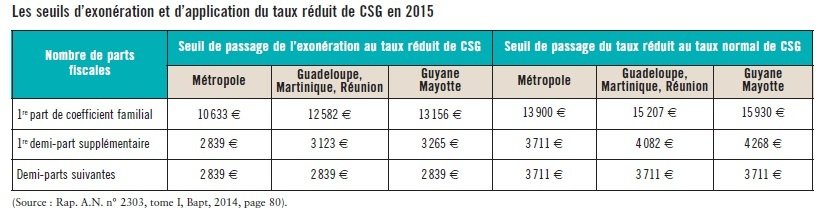Adoptée définitivement par le Parlement le 1er décembre et validée pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel le 18 décembre, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015 doit permettre le redressement des comptes sociaux grâce à des « efforts significatifs sur les dépenses », a insisté le gouvernement lors de la présentation des grandes lignes du projet de loi initial en octobre dernier. La loi s’inscrit en effet dans le cadre de son engagement d’économiser 50 milliards d’euros d’ici à 2017, dont 20 milliards portant sur les dépenses de protection sociale(1). L’objectif, cette année, est donc encore de contenir le déficit du régime général de la sécurité sociale (11,6 milliards d’euros en 2014) qui, sans mesures de redressement, pourrait attei
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?