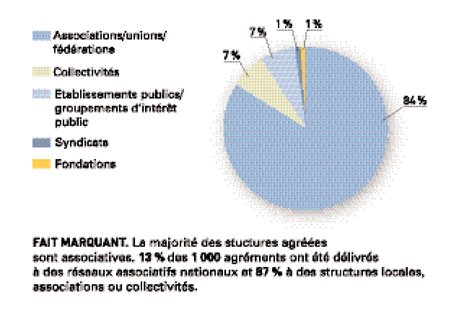« Donner à tous la possibilité de s’engager au service d’un projet collectif d’intérêt général et des valeurs de la République » dans un cadre juridique « revu, dépoussiéré, rendu plus visible et plus simple. » L’ambition affichée par le sénateur (RDSE) Yvon Collin, il y a plus d’un an, lors de la présentation du texte qui aboutira à la loi relative au service civique, était claire : réussir là où le service civil volontaire institué en 2006 au lendemain de la très grave crise des banlieues avait échoué (1). Un dispositif « mal conçu et insuffisamment préparé », « pas assez attrayant ni suffisamment adapté pour atteindre ses objectifs ». Et souffrant d’un triple déficit, expliquait Yvon Collin au cours des débats au Palais du Luxembourg�
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?